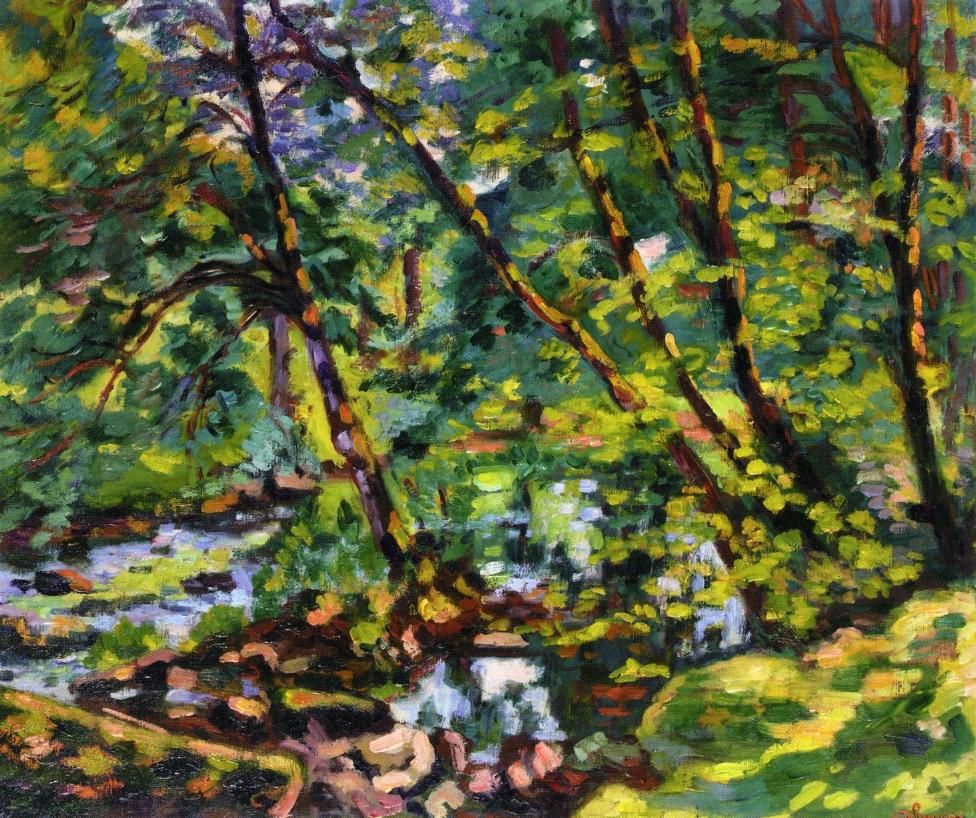[d’après l’intervention "Brunch au MARQ" du 17 évrier 2013
« Montferrand, 17 août 1550… »]
[Le Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ) conserve dans sa salle consacrée aux arts de la Renaissance deux panneaux parquetés peints, au modèle relativement peu commun dans les collections muséales.]
Mesurant respectivement 90 cm par 63 cm pour l’un et 95 cm par 70 cm pour l’autre, ils figuraient déjà en 1861, sous les n°40 et 41, au catalogue des collections du Musée d’Art et d’Histoire de Clermont-Ferrand. Provenant des archives de l’ancienne cité de Montferrand, ils étaient sans doute conservés parmi celles-ci depuis le milieu du XVIe siècle.
Montferrand, siège de juridiction royale
A l’époque Montferrand se revendique comme l’une des principales villes d’Auvergne. Fondée dans le premier quart du XIIe siècle par le Comte d’Auvergne Guillaume, elle fut constamment favorisée par ses successeurs qui cherchaient à disposer d’une cité capable de rivaliser avec Clermont, siège et possession de l’évêque. Poursuivant une stratégie similaire, les Valois s’en servent depuis le début du XVe siècle comme d’un poste avancé du pouvoir royal, dans le dos des Ducs de Bourbon, à deux pas de Riom, siège de la sénéchaussée ducale.
En 1425, c’était essentiellement dans ce but que Charles VII décidait d’installer un baillage royal à Montferrand. Le visage social de la ville fut profondément changé par l’importance qu’Hervé du Mesnil, le premier de ses baillis, réussit à donner à cette nouvelle juridiction[1]. A la bourgeoisie marchande, assez aisée mais peu nombreuse, s’adjoignit une bourgeoisie d’officiers et d’hommes de lois. L’arrivée dans la cité d’avocats et de plaideurs, venant parfois d’assez loin, assura de nouveaux profits aux aubergistes et commerçants. Grâce à ces nouveaux clients, l’activité des artisans pu également s’accroître.
En ce milieu du XVIe siècle, cette prospérité explique toute la vigueur mise par les habitants de Montferrand, et leurs consuls, à défendre leur baillage. Après la "trahison" du Connétable de Bourbon, le retour à la Couronne de l’apanage d’Auvergne vient de lui faire perdre l’essentiel de son rôle stratégique tandis que ses prérogatives réelles sont redevenues bien maigres avec la réaffirmation de celles du baillage de Saint-Pierre-le-Moustier[23].
C’est à l’aune de cette crainte du déclin que peuvent être étudiées les deux panneaux du MARQ.
![pzn1-copie-1]() Une allégorie et un blason
Une allégorie et un blason
Sur le premier panneau est peint un personnage féminin, assis sur une estrade tirée par deux chevaux.
Les roues peintes du char, avec leurs rayons en balustre, sont caractéristiques du style de la renaissance.
Le paysage est simple. Le ciel n’est pas peint, le bois du panneau restant nu et le bleu étant réservé à la réalisation du fond de six phylactères. Le sol est représenté au naturel, vert ; le char roule sur un chemin de terre caillouteux. Sans doute pour donner une sensation de relief, et de manière assez maladroite, le peintre a doté toutes chosesd’ombres, depuis les rênes du char jusqu'à la chevelure du personnage, en passant par la plus petite des pierres.
La jeune femme est vêtue simplement, mais assez richement. ![pallas]() Sur une cotte d’étoffe brune et aux manches longues, elle porte une robe rouge à manches courtes ; sur le tout, une cape bleue-verte, aux bords marqués par trois liserés dorés, est tenue par un cordon noué à l’épaule droite. Au cou, sur la chemise, un collier semble pourvu d’une médaille dissimulée sous la robe. Le décolleté carré de la robe est typique de la renaissance mais l’ensemble peut apparaître comme composite au regard de l’habillement des femmes de la cour à cette même époque. La chemise est ainsi fermée au niveau du cou masquant totalement la gorge. On peut aussi considérer que, plus que des aspects médiévaux, cet habillement présente des aspects provinciaux ou, plus simplement encore, que le peintre, voulant représenter une allégorie, a choisi de rendre plus simple et plus sage son personnage.
Sur une cotte d’étoffe brune et aux manches longues, elle porte une robe rouge à manches courtes ; sur le tout, une cape bleue-verte, aux bords marqués par trois liserés dorés, est tenue par un cordon noué à l’épaule droite. Au cou, sur la chemise, un collier semble pourvu d’une médaille dissimulée sous la robe. Le décolleté carré de la robe est typique de la renaissance mais l’ensemble peut apparaître comme composite au regard de l’habillement des femmes de la cour à cette même époque. La chemise est ainsi fermée au niveau du cou masquant totalement la gorge. On peut aussi considérer que, plus que des aspects médiévaux, cet habillement présente des aspects provinciaux ou, plus simplement encore, que le peintre, voulant représenter une allégorie, a choisi de rendre plus simple et plus sage son personnage.
L’artiste a cherché à conserver les détails et un certain souci du réel. Les deux animaux - hongres ou étalons dont on distingue nettement les fourreaux péniens - sont ferrés, portent un harnachement complet et ont les crins de la queue noués. Le choix de leur robe par le peintre n’est sans doute pas anodin. Les chevaux auvergnats, notamment de trait ou demi-trait ayant en général une robe foncée, le choix du blanc présente vraisemblablement un caractère symbolique.
Malgré ce désir de vérité, le format du panneau a imposé au peintre une compression des objets. Le cheval du premier plan est ainsi presque difforme, le corps excessivement raccourci, le tronc réduit à presque rien.
Pour le cheval du second plan, le peintre a utilisé un autre artifice tout aussi peu naturel. Il l’a en effet représenté dans un plan situé derrière le char devant lequel il est pourtant censé être attelé.
Les plaques de poitrail des deux bêtes sont ornées des mêmes armes que celles portées sur le second panneau.
Sur celui-ci est en effet représenté, sur fond rouge, un blason qui se lit de sable (noir) à la croix d’argent (blanc) le tout chargé d’un lambel de gueules (rouge). L’écu est entouré du grand collier de l’Ordre de Saint-Michel.
![stgeorges]() La figure de l'archange terrassant le dragon est aisément reconnaissable sur le médaillon ornant le grand collier de l'Ordre de Saint-Michel (panneau armoirié) La figure de l'archange terrassant le dragon est aisément reconnaissable sur le médaillon ornant le grand collier de l'Ordre de Saint-Michel (panneau armoirié) |
|
![jeandalbon]() Jean d'Albon-de-Saint-André, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel et père du maréchal de Saint-André, par l'atelier de Corneille de Lyon (tableau également visible au MARQ) Jean d'Albon-de-Saint-André, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel et père du maréchal de Saint-André, par l'atelier de Corneille de Lyon (tableau également visible au MARQ) |
Dès 1934, Henri du Ranquet rejette l’hypothèse qui attribuait ces armes aux chevaliers de Saint-Jean-de-Ségur[2] et les identifient comme étant celles de Jacques d’Albon-de-Saint-André[3], maréchal de France et chevalier de l’Ordre de Saint-Michel[4]. [...]
Un maréchal de France en Auvergne
Les Albons de Saint-André
Depuis le XIIIe siècle, génération après génération, et par un jeu de subtiles alliances matrimoniales, la famille d’Albon a réussi à se hisser dans la meilleure noblesse du Lyonnais et du Forez, puis a solidement s’implanter en Bourbonnais et en Auvergne[5]. Parallèlement, sans doute aidée par sa proximité avec les sires de Beaujeu, ducs de Bourbon, elle s’est faite remarquée à la cour des Valois. Au début du XVIe siècle Guichard d’Albon[6] assure à plusieurs reprises des commandements militaires pour le Roi et est désigné par celui-ci comme bailli de Montferrand. Son fils Jean, grand officier royal, chambellan des enfants de François Ier, est, tour à tour, gouverneur d’Auvergne et gouverneur du Lyonnais. [...]
C’est également en sa qualité de gouverneur d’Auvergne que se présente devant Montferrand, le 17 août 1550, Jacques d’Albon, dit le Maréchal de Saint-André, petit-fils et fils des précédents.
Le personnage mérite que l’on s’attarde quelques instants sur lui.
Elevé pour partie à la cour de France, Jacques d’Albon est des premiers compagnons d’Henri de Valois. Il en restera un proche toute sa vie.
Il semble que son union, en 1544, avec Marguerite de Lustrac ne fut pas appréciée par François Ier, tenant le jeune favori – un temps - éloigné de la cour. Mais en 1547, à la mort du Roi, sa position est rapidement assise. Avant même le sacre, il est nommé premier gentilhomme du Roi puis maréchal de France. Au sacre, il remplace Montmorency comme grand maître de France ; il a alors 34 ans.
Moins de deux ans plus tard, après une ambassade auprès d’Edouard VI[7], il est désigné aux charges laissées vacantes par le décès de son père, notamment à celle de Gouverneur du Lyonnais, du Dauphiné, de Haute et Basse Auvergne[8].
Bien qu’illustre en son temps, le Maréchal de Saint-André reste aujourd’hui peu connu. Lucien ROMIER, dans l’ouvrage qu’il lui a consacré, le considère avant tout comme un habile favori qui dépensa sans compter pour le luxe de ses demeures[9].
Il semble qu'effectivement Jacques d’Albon ait été particulièrement jaloux du rang atteint par son père et par lui-même. Pour figure de sa devise il prend rien de moins que le glaive d’Alexandre-le-Grand[10] quand le Duc d’Orléans se choisissait une simple massue et le Duc de Bourgogne un rabot de charpentier.
Pour l’office de quarantaine, célébré sur ses terres de Saint-André dans l’hiver 1549-1550 suite aux obsèques de son père, il demande avec insistance la participation des villes de son gouvernements. La cité de Lyon désigne ainsi quatre représentants, auxquels elle doit faire réaliser des robes de deuil avec capuchonauxquels elle doit faire réaliser des robes de deuil avec capuchon, et qu'elle fait accompagner de vingt-quatre torches munies de ses armoiries [11]. Les consulats des villes allaenit rapidement apprendre que cette exigence, déjà inhabituelle, ne serait que la première d’une longue série. [...]
A la fin du printemps suivant, ayant été désigné aux fonctions autrefois occupées par son père, Jacques d’Albon entreprend donc une "tournée" dans les villes de ses "gouvernements". La plupart de celles-ci l’accueillent lors de cérémonies d’entrée solennelle et Montferrand ne fait pas exception.
Entrée solennelle et procession
Pour la ville, il en va alors de son prestige et de la reconnaissance de son rang parmi les bonnes villes d’Auvergne. A l’époque, ce cérémonial est pour une Cité l’occasion de se mettre en évidence auprès de son illustre visiteur. Aussi, Montferrand n’a t’elle jamais ménagé ses efforts lors des entrées solennelles des hauts personnages qui se sont successivement présentés devant ses murs, que ce soit le Connétable de Bourbon, Jean Stuart, le Duc d’Albanye, gouverneur d’Auvergne[12], François de Tournon, l’archevêque de Bourges ou le Roi de Navarre.
Alors que la venue de Saint-André est prochaine, ce souci du bien paraître est tel que les consuls de Montferrand prennent la précaution de bien s’informer sur la manière dont les autres villes reçoivent le nouveau gouverneur. Une rétribution est ainsi versée à Pierre Verdières « qui alla jusques a Gannat veoir la forme des entrees pour le rapporter a la ville »[13]. De la même manière, quinze ans plus tôt, Jean Bonhomme avait été envoyé à Riom pour vérifier de quelle façon cette ville se préparait à l’entrée du Roi et de la Reine de Navarre[14]. Il s’agit de ne pas faire chiche par rapport aux autres.
L’entrée dans une ville est un grand classique de l’affirmation du pouvoir royal, notamment au moment de l’accession au trône du souverain. Pour le Roi elle fait partie des quatre cérémonies majeures avec le lit de justice, le sacre et les funérailles[15] ; à la différence de ces deux dernières, elle peut être relativement fréquente[16].
Tout au long du XVIe siècle le rituel de l’entrée passe de plus en plus du schéma médiéval de l’entrée du Christ à Jérusalem, le jour des rameaux, au triomphe à la romaine, éventuellement combiné à des aspects nuptiaux (dont relève, pour partie, la cérémonie de remise des clefs) où chaque ville serait l’épousée[17].
Conservant des schémas de la procession religieuse, la procession d’entrée en ville est beaucoup plus bruyante et festive. On y joue des scènes et pour l’entrée solennelle de Jacques d’Albon à Montferrand, le « fatiste qui fist la composition du jeu qui fust joué » reçut deux écus de la ville18. Des musiciens sont conviés et on banquette « en cher de veau, mouton que bœuf »[19]. Comme le fait remarquer Fabien SALESSE, Montferrand a un tel souci de s’affirmer que même la fête est prétexte à une compétition[20].
Le 17 août 1550, les consuls de Montferrand et « troys petitz enfenz vestuz de vert et de blanc, coleurs dudict seigneur»[21] [sic] accueillent donc le Maréchal de Saint André qui est accompagné de son cousin germain, Nectaire de Saint-Nectaire, gentilhomme de la chambre du Roi et bailli de Saint-Pierre-le-Moustier[22]. Le cortège se rend ensuite place des Taules où, comme à l’habitude, un échafaud a du être dressé pour les " discours ".
C’est sans doute sur cet échafaud que devaient être fixés les deux panneaux du Musée d’Art Roger-Quilliot.
Une allégorie
…de la Victoire…
Même si elle présente un visage serein et inspiré, très fréquent dans la peinture religieuse, la jeune femme représentée n’est pas une sainte et, jusqu’à présent, elle a toujours été considérée comme une allégorie de la victoire. Ses cheveux sont défaits, ses mains sont nues, la droite tenant fermement une lance ; sa tête est ceinte d’une couronne végétale dont on pourrait supposer qu’il s’agit d’une couronne de laurier.
Assise sur une lourde estrade tirée par deux chevaux, elle est représentée en situation de triomphe. Les représentations de ce type sont caractéristiques. Parmi les plus célèbres on peut penser aux exemples de l’Hôtel de Bourgtheroulde, à Rouen, qu’il s’agisse des quatre chars de triomphe du cycle de Pétrarque[aa], de celui de Cybèle tiré par quatre lions ou de celui d’Hercule tiré par deux chevaux. L’identification à une Athéna Nikë est donc cohérente.
Cette identification se trouve renforcé par un phylactère qui porte explicitement la désignation « Pallas », autre épiclèse d’Athéna et épiclèse d’ailleurs le plus fréquemment utilisé dans la France de la Renaissance.
Pallas porte des souliers bruns et une étoffe nouée en guise de ceinture mais c’est sa robe rouge qui, quoique simple, peut attirer notre attention par la riche broderie qui l’orne, au moins sur sa partie supérieure. Peut-être est-ce purement esthétique ; peut-être ceci répond t’il à une volonté du peintre de la mettre en harmonie avec le fastueux cortège auquel Athéna, immobile, participe néanmoins ; Peut-être aussi s’agit-il d’évoquer une caractéristique de cette femme qu’Homère nous décrit comme étant celle qui « laisse couler sur le sol de son père la robe souple et brodée qu'elle a faite et ouvrée de ses mains »[24].
Déesse de la Victoire, lorsqu’elle est Athéna Nikë, la déesse aux yeux pers est un personnage récurent des entrées solennelles. A Rouen, en février 1532, on fait ainsi défiler devant le dauphin et surtout Eléonore d’Autriche, nouvelle épouse de François Ier, trois chars portant Mercure, Junon et Pallas traînés par des animaux ou des muses, précédés d’allégories et suivies par une foule de divinités[25]. Le choix de deux déesses, l’une, sœur et épouse, et l’autre fille préférée de Zeus/Jupiter peut apparaître comme opportun lorsque l’on souhaite honorer – et éventuellement se concilier - une Reine de France, sœur d'un empereur.
Autre exemple, vraisemblablement connu des consuls de Montferrand : l’entrée royale dans Lyon d’Henri II et Catherine de Médicis. En 1548, parmi les scènes mythologiques qui sont jouées, celle qui est donnée place du Change représente un épisode du conflit entre Pallas et Poséidon au sujet d’Athènes[26]. Les magistrats de Lyon voyaient-ils alors leur ville en nouvelle Athènes ?!?
Jacques d’Albon se pense avant tout en soldat. Visiblement admiratif de la manière dont Alexandre de Macédoine régla la question du nœud gordien – dont le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’était pas des plus diplomatique – il a choisit pour devise "nodos virtute resolvo" - "la valeur se joue des difficultés" - et considère, comme d’ailleurs la plupart des nobles de son époque, que c’est dans les faits militaires que la renommée doit se trouver. Même si on a du mal à estimer quels hauts faits auraient permis, en 1550, de l’invoquer, la présence de la déesse de la guerre et de la victoire sur les panneaux accueillant le Maréchal de Saint-André ne pouvait que flatter un homme dont on dit qu’il entendait être honoré à l'égal d'un prince voire d'un Roi[27].
…recyclée…
Pour autant le haut et puissant seigneur Jacques d’Albon n’était ni l’un ni l’autre. La ville de Lyon s’était d’ailleurs étonnée de la demande du Maréchal de Saint-André d’une entrée solennelle[28] et, face au coût prévisible, le consulat avait préféré faire trancher la question par soixante cinq de ses principaux notables. Sans l’insistance du Maréchal de Saint-André, le consulat se serait volontiers contenté de l'honorer par un petit présent comme, dix ans auparavant, il l’avait fait pour son père par l'offrande d'une coupe d’argent dorée.
De la même manière, si en 1533 la ville de Montferrand avait commandé à un orfèvre clermontois, pour 43 livres et demi, une pièce d’orfèvrerie représentant une montagne avec, à son pied, un lion couché devant une fleur de lys[29] afin de l’offrir à François Ier, il n’y a aucune trace d’un tel présent pour le gouverneur d’Auvergne. Pas de trace non plus d’un arc de triomphe et quelques musiciens seulement quand il avait fallu payer, pour l’entrée de François Ier, un tambourin de Suisse, dix trompettes à cheval venant de Vertaizon[30], des joueurs de rebecs et au moins seize ménestriers.
Pour Montferrand, le souci d’économie ne pouvait être absent ; et cette cérémonie avait un coût. La dépense totale pour l’ensemble des manifestations faite à l’occasion de l’entrée de Jacques d’Albon atteignit deux cent vingt quatre livres, six sols, quatre deniers[31].
Montferrand veut faire des économies. Elle a donc « prins les escussons que estoyent au vieux pouelle[32] qui avoist esté donne a la freyrie de la Feste-Dieu, pour mectre au poele a monsieur le marechal et gouverneur »[33].
Voilà pourquoi, si on observe plus attentivement les plaques de poitrail des chevaux du panneau du MARQ, sous le blason des Albon de Saint-André, on distingue un autre blason. Difficile à lire il semble être "au chevron" apparemment "accompagné de deux croix pattée en chef et d’un croissant en pointe". Le panneau est donc de ceux qui ont été réemployés, recyclés, et il ne connaissait pas là sa première utilisation.
N’ayant pas encore réussi à identifier ces armoiries, intéressons nous au message de ce panneau.
ou une allégorie de la raison et du droit ?
D’abord le plus simple à aborder, les inscriptions contenues dans les phylactères.
Quatre d’entre eux portent des noms de vertus :
Il s’agit des quatre vertus cardinales désignées ainsi car ce sont des vertus qui font la charnière dans le comportement humain. A la différence des trois vertus théologales, la foi, l’espérance et la charité[34], il s’agit de vertus morales dont le concept remonte à l’Antiquité païenne et que Platon présentait comme les vertus fondamentales nécessaires à l’Etat. Ces principes seront bien évidemment christianisés par une série de penseurs dont on peut citer Saint Augustin ou Saint Thomas d’Aquin. Ce dernier, suivant Aristote et son souci du respect de la liberté individuelle, élabora une synthèse respectant les deux composantes de l’agir moral, la naturelle (vertus cardinales) et la surnaturelle[35].
A l’époque où ce panneau est réalisé, ce principe des vertus cardinales n’a encore eu à subir ni les contrecoups des réformes protestantes et tridentines, ni la sécularisation qui caractérisera la société à partir du XVIIIe siècle et qui sera particulièrement visible en France avec l’apparition de la vertu républicaine[36].
Ainsi ce panneau incite t-il à la prudence, la prudence qui ne doit pas être comprise dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui mais comme le l’analyse raisonnable des choses entraînant l’action rationnelle ; ce qui n’exclut donc pas nécessairement l’héroïsme.
Vient ensuite la vertu qui doit régler ses relations à autrui : la justice.
Enfin sont les vertus qui portent sur la vie personnelle et qui permettent à chaque individu, en conscience et liberté, de gouverner son esprit et son corps : la tempérance, qui modère et règle les passions, et la force, qui est synonyme de résolution mais aussi de lucidité, de constance, bref de capacité à agir face aux obstacles et à ses propres faiblesses.
Vous me ferez alors observer que si sur ce panneau sont bien mentionnées la prudence, la justice et la tempérance, le quatrième phylactère invite à la magnanimité et non à la force. Il s'agit d'une vertu qui est souvent adjointe aux vertus cardinales et, si Thomas d'Aquin la considère comme une partie de la vertu « Force », elle était aussi, pour Ciceron, une vertu moins personnelle et plus politique, au même titre que la libéralité ou l’honnêteté, vertus nécessaires à un bon gouvernement.
S'opposant à la vanité qui pousse vers des buts qui ne peuvent être atteint, corollaire de la compréhension et de la clémence, elle est aussi, à la Renaissance[bb], la vertu par excellence du magistrat.
Voilà qui semble intéressant, d’une part parce que le grand phylactère porte justement « Immortale aevum decori justicie » « Moment impérissable pour la gloire de la justice » et que, d’autre part, Montferrand est alors une ville d’hommes de loi.
Dans ce contexte, quel rôle pour Pallas !
Pallas et Pallas !
La Renaissance c’est la redécouverte de l’Antiquité gréco-romaine dans l’art, mais aussi la ré-appropriation de ses mythes. Pendant toute la période, Athéna est fréquemment représenté par les artistes. …. De Léonard Sarson, par exemple, on connait une sculpture d’andésite représentant Pallas et qui se trouve, au MARQ, à deux pas de nos panneaux.
La déesse est représentée avec un léger déhanchement qui donne l’impression qu’elle marche. L’œuvre avait été commandée pour orner l’Hôtel de Ville de Clermont inauguré en 1581. S’il semble n’avoir travaillé qu’en Auvergne[37]– on trouve Léonard Sarson œuvrant au Moutier Saint-Robert de Montferrand en 1547, à l’Hôtel-Dieu en 1567, au Palais de Justice à la fin des années 1570 – son style est bien dans celui de l’époque. LEs deux représentations sont distantes de 32 ans[38] mais leur comparaison a néanmoins quelque intérêt. La Pallas de Sarson est bien représentée en déesse de la guerre, toute caparaçonnée comme lorsqu’elle sortit de la tête de Zeus, elle est munie d’une lance, d’un casque et sur son bouclier est fichée la tête de Méduse. Seule la chouette représentée à ses pieds rappelle qu’elle est aussi la déesse de la sagesse.
L’Athéna du panneau est bien plus pacifique[cc]. N’oublions pas que, née en armes, Athéna est aussi déesse de la sagesse, de la raison. Fille de Métis, le conseil, elle guide les Dieux lors de la gigantomachie et si, pendant la Guerre de Troie, elle combat Arès, elle en conseille surtout les héros.
Déjà sous l’antiquité, elle était, par opposition à Arès, dieu brutal, la déesse d’une guerre réglée obéissant à des codes précis et reconnus.
Elle donne à Béllérophon les rênes lui permettant de dompter Pégase. Remarquez justement comme sur ce panneau les deux bêtes sont cabrées, langue sorties, semblant tendues vers l’action voire la fureur guerrière et comment Pallas en tient les rênes, solidement, presque sereinement.
Quand, en 1482, Boticelli la représente avec un centaure, elle incarne la raison maitre de la bestialité[39].
![botticelli.jpg]() |
![pallas]() |
![parmesan.jpg]() |
| Représentée par Botticelli en 1482 ou par Le Parmesan vers 1539, la chaste déesse est aussi la "déesse à l'opulente chevelure" |
Outre Béllérophon, Pallas conseille aussi Héraclès ou Persée, autres tueurs de monstres, image du chaos et de la discorde. D'ailleurs elle n'assiste que les héros qui apportent la cohésion par la civilisation, respectent le droit, voire revendiquent le leur (Cadmos, fondateur de Thèbes, pourfendeur de dragon et introducteur de l’alphabet en Grèce, Télémaque, l’héritier légitime d’Itaque, etc).
Elle se fait aussi l’avocate d’Oreste face aux Erynies.
Déesse à l’opulente chevelure, elle est celle qui a donné à Athènes, sa constitution et son premier Tribunal[40]. Quand elle combat, c’est pour maintenir l’ordre et les lois.
Regardons là mieux sur ce panneau ! A sa tête, pas de casque mais une couronne d’olivier[41] et dans ses mains, aucun gorgoneion mais un registre ou un codex !
Jacques d’Albon – et beaucoup d’autres – on put la prendre pour une allégorie de la victoire, alors qu’elle est en réalité une allégorie de la raison, du bon conseil et surtout du droit.
Il reste encore à déterminer dans quelles circonstances ce panneau avait été initialement réalisé.
Simon RODIER
aa : Celui de la chasteté tiré par deux licornes, celui de la mort tiré par des bœufs, celui de la renommée tiré par des éléphants, celui du temps tiré par quatre chevaux, celui de la Trinité tiré par les quatre Vivants.
bb : Notamment depuis la "redécouverte" du "De Clementia" de Sénèque.
cc : En comparaison, également, de l'Athéna du tableau "Minerve chassant les vices du jardin de la vertu" d'Andrea Mantegna (visible au Musée du Louvre)
1 : BOSSUAT, André, Le baillage royal de Montferrand (1425-1556), Paris, PUF, 1957.
2 : C'est-à-dire l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ou Ordre de Malte.
3 : RANQUET, Henri (du), in Revue l’Auvergne Littéraire, Artistique et Historique, n°74, Clermont-Ferrand, 1934.
4 : comme le fut d’ailleurs son père Jacques d’Albon
5 : A ce sujet, on pourra utilement se reporter aux articles dématérialisés de Sébastien TOUZEAU (http://gw4.geneanet.org/charaltouvi?lang=fr;m=NOTES;f=Alliances)
6 : Il était fils de Gillet d’Albon qui avait adjoint aux armes familiales le lambel de gueules, caractéristique des branches puinées, étant le fils cadet de Jean d’Albon de Lespinasse et de Guillemette De Laire. La branche aînée, celle des seigneurs de Saint-Forgeux à la suite de Guillaume d’Albon II seigneur de Curis, continua de blasonner simplement de sable à la croix d’argent.
7 : Rien ne permet de croire, comme l’on écrit certains auteurs, qu’il fut fait à cette occasion chevalier de l’Ordre de la Jarretière.
8 : Il semble qu’il s’agisse du renouvellement d’une faveur spéciale puisque si Jean d’Albon, son père, avait été nommé à cette fonction par Henri II, dès 1547, c’était déjà en contradiction totale avec un édit royal de 1545 dans lequel François Ier proclamait qu’il n’y aurait plus aucun gouverneur dans les provinces n’étant pas des provinces-frontières.
9 : ROMIER Lucien, La carrière d'un favori : Jacques d'Albon de Saint-André, maréchal de France (1512-1562), Paris, Perrin, 1909.
10 : Celui-ci est ainsi visible sur la fontainedu château de Coutras, érigée sur les ordres du Maréchal de Saint-André et dite « Puit Henri IV ».
11 : Archives municipales de Lyon, Registres des délibérations consulaires, BB70 f°194 et suivants :
« Le vendredi vingt quatre(ièm)e jour de l’année l’an mil cinq cens quarante neuf, en la maison de sire Anthoine Boni aux Changes après midy.
Claude Laurencin seigne(ur) de Riverye, Françoys Duperier seigneur d’Ouzielles, Humbert de Masses, Anthoyne Bonis, Jehan Passy dict Bello, Guillaume Regnaud et Catherin Trys, Conseillers,
On estez leues, par lesdits seigneurs conseillers, les lectres missives escriptes par Monsieur le Maréchal Saint André, Lieutenant général et Gouverneur pour le Roy en la ville de Lyon et Pays de Lyonnays, à messieurs les lieuten(ants) Dupeyrat et Recepveur Martin de Troyes, par lesquelles l leur mande, entre aultres, que le Roy entend estre faictes les obsèques et funérailles de feu Mons(ieu)r de Sainct André, son père, jadis gouverneur et Lieutenant Général pour le Roy en ladicte ville et Pays de Lyonnoys le plus honorablement qui faire se pouvra et qu’il est très nécessaire que pour chacun des Pays où il estoit gouverneur y assistent deux ou troys des plus notables personnaiges et rep(rese)ntant le siège principal et icelluy pays avec leurs armoyries aux torches qu’ils porteront suyvant l’ordre qu’on leur declairera et que, à ces fins ils advertissent de bonne heure ceux de ceste ville pour assister à l’enterrement et quarentaine dudict feu seigneur de Sainct André son père au jour qu’il leur sera assigné.
Sur quoy, après avoir amplement délibérer par lesdicts seigneurs conseillers, estants adverty [par ledit s(eigneur) receveur Martins de Troyes] que le


 Pleins feux sur les collections du Musée Mandet
Pleins feux sur les collections du Musée Mandet
 Cette fois, c'est un documentaire que l'AMA et le cinéma Le Rio vous invite à découvrir.
Cette fois, c'est un documentaire que l'AMA et le cinéma Le Rio vous invite à découvrir.
 Jusqu'au 30 mars 2014, le cabinet des arts graphiques du MARQ vous propose une traversée dans le temps avec une sélection d’une trentaine d’oeuvres issues du fonds d’arts du musée.
Jusqu'au 30 mars 2014, le cabinet des arts graphiques du MARQ vous propose une traversée dans le temps avec une sélection d’une trentaine d’oeuvres issues du fonds d’arts du musée. Une allégorie et un blason
Une allégorie et un blason Sur une cotte d’étoffe brune et aux manches longues, elle porte une robe rouge à manches courtes ; sur le tout, une cape bleue-verte, aux bords marqués par trois liserés dorés, est tenue par un cordon noué à l’épaule droite. Au cou, sur la chemise, un collier semble pourvu d’une médaille dissimulée sous la robe. Le décolleté carré de la robe est typique de la renaissance mais l’ensemble peut apparaître comme composite au regard de l’habillement des femmes de la cour à cette même époque. La chemise est ainsi fermée au niveau du cou masquant totalement la gorge. On peut aussi considérer que, plus que des aspects médiévaux, cet habillement présente des aspects provinciaux ou, plus simplement encore, que le peintre, voulant représenter une allégorie, a choisi de rendre plus simple et plus sage son personnage.
Sur une cotte d’étoffe brune et aux manches longues, elle porte une robe rouge à manches courtes ; sur le tout, une cape bleue-verte, aux bords marqués par trois liserés dorés, est tenue par un cordon noué à l’épaule droite. Au cou, sur la chemise, un collier semble pourvu d’une médaille dissimulée sous la robe. Le décolleté carré de la robe est typique de la renaissance mais l’ensemble peut apparaître comme composite au regard de l’habillement des femmes de la cour à cette même époque. La chemise est ainsi fermée au niveau du cou masquant totalement la gorge. On peut aussi considérer que, plus que des aspects médiévaux, cet habillement présente des aspects provinciaux ou, plus simplement encore, que le peintre, voulant représenter une allégorie, a choisi de rendre plus simple et plus sage son personnage.



 Le 2 mars 2012 une vente aux enchères de livres anciens se tenait à Clermont-Ferrand. L'un d'eux suscita notre curiosité ayant également attiré l’attention de la conservation du Musée Bargoin : le catalogue manuscrit d'un clermontois de la fin du XIXe siècle, collectionneur d'objets antiques.
Le 2 mars 2012 une vente aux enchères de livres anciens se tenait à Clermont-Ferrand. L'un d'eux suscita notre curiosité ayant également attiré l’attention de la conservation du Musée Bargoin : le catalogue manuscrit d'un clermontois de la fin du XIXe siècle, collectionneur d'objets antiques.



 Sur le premier panneau est peint un personnage féminin, assis sur une estrade tirée par deux chevaux.
Sur le premier panneau est peint un personnage féminin, assis sur une estrade tirée par deux chevaux. Elevé pour partie à la cour de France, Jacques d’Albon est des premiers compagnons d’Henri de Valois. Il en restera un proche toute sa vie.
Elevé pour partie à la cour de France, Jacques d’Albon est des premiers compagnons d’Henri de Valois. Il en restera un proche toute sa vie.





_(1).jpg)